II. Définition de la démocratie directe
Préambule

"Biais cognitif"
Après avoir lu le présent chapitre, le lecteur réalisera la prégnance des biais cognitifs dans lesquels nous ont enfermés la dialectique et le vocabulaire du système "représentatif", notamment en associant abusivement les mots "vote" et "élection".
En rédigeant le présent chapitre, je me suis rendu compte que l'évolution vers la DD va nécessiter un travail de déconstruction & reconstruction, de nature véritablement culturelle, raison pour laquelle cette évolution sera probablement lente. Et cela d'autant plus que les populations ont été maintenues dans une forme "d'analphabétisme politique", depuis plusieurs siècles.
Ainsi tout le travail politique que les populations ont été autorisées à fournir à ce jour se limite à élire des représentants tous les quatre ou cinq ans ... Le système à déconstruire est donc simpliste, et pourtant sa déconstruction est une tâche ardue, car ce simplisme vise à masquer une réalité dont la potentialité politique est liée à sa complexité systémique.
Pour faciliter ce travail de réajustement cognitif, le présent chapitre est décomposé en deux parties principales :
- déconstruction analytique de la dialectique et du vocabulaire du système "représentatif" ;
- reconstruction – à partir du vocabulaire adéquat (éventuellement après redéfinitions) – d'un système politique direct (mais ne rejetant pas pour autant le principe de délégation). Il s'agit ici de réduire la complexité systémique de l'idéal de DD à quelques principes essentiels.
Cependant, étant donné que l'objet du présent chapitre est de définir la DD, c'est par le travail de reconstruction conceptuelle que nous commencerons (section "Principes de base"), qui sera suivi par le travail de déconstruction analytique du système représentatif (section "Analyse", qui permet d'approfondir la compréhension de la précédente, par comparaison "aujourd'hui vs demain"). Enfin nous terminerons par une section rappelant que la Constitution, qui définit le système politique, ne suffit pas pour autant à sa réalisation.
Principes de base
Le système de DD que nous proposons de concevoir et développer collectivement repose sur six principes de base :
Primauté du "référendum supérieur" sur la délégation collective et le tirage au sort.
Les référendums sont d'initiative populaire et automatiques, c-à-d gérées par des procédures inscrites dans des contrats intelligents, et utilisables à tout moment par tout citoyen (il pourrait donc il y avoir en permanence plusieurs votations courantes) [approfondir].
- Deux types de délégation :
individuelle, pour une votation spécifique : le votant peut déléguer son droit de vote à une personne de son choix, laquelle peut éventuellement déléguer les droits dont elle dispose, et ainsi de suite (délégation "en cascade" rendant possible la spécialisation) ("démocratie liquide") ;
collective, pour une période déterminée : les délégués sont tirés au sort, si nécessaire dans des pools de candidats répondant à des critères de compétence [approfondir].
Deux types de délégué : humain ou artificiel (systèmes ouverts d'intelligence artificielle, dans le cadre de contrats intelligents).
La DD blanche rejette l'utilisation de la délégation à une IA, ainsi que le vote par Internet.
Complétude. Les principes précédents sont applicables à toutes les échelles et types de pouvoir :
- échelles géographiques : communale, nationale, internationale ;
- types constitutionnels : législatif, exécutif, judiciaire.
Les groupes constituants déterminent tout ce qui reste à déterminer pour obtenir un système de DD opérationnel, et le faire évoluer, en appliquant la méthodologie ICAO. Leur propositions doivent être validées par référendum automatique. Leur fonction est ainsi permanente, de sorte que la Constitution de DD peut s'adapter à une société qui évolue de plus en plus vite.
Les groupes constituants devront notamment déterminer dans quels cas, sous quelles conditions et selon quelles procédures est appliquée (i) la délégation individuelle vs collective, et (ii) la délégation à une IA vs un humain. Et cela pour chaque type constitutionnel (législatif, exécutif, judiciaire) et chaque type géographique (législatif, exécutif, judiciaire). C'est donc un travail considérable, que la méthode ICAO vise précisément à rendre possible.
Le schéma suivant permet de saisir visuellement les relations entre les principes de base ci-dessus.
Schéma des principes de base de la DD
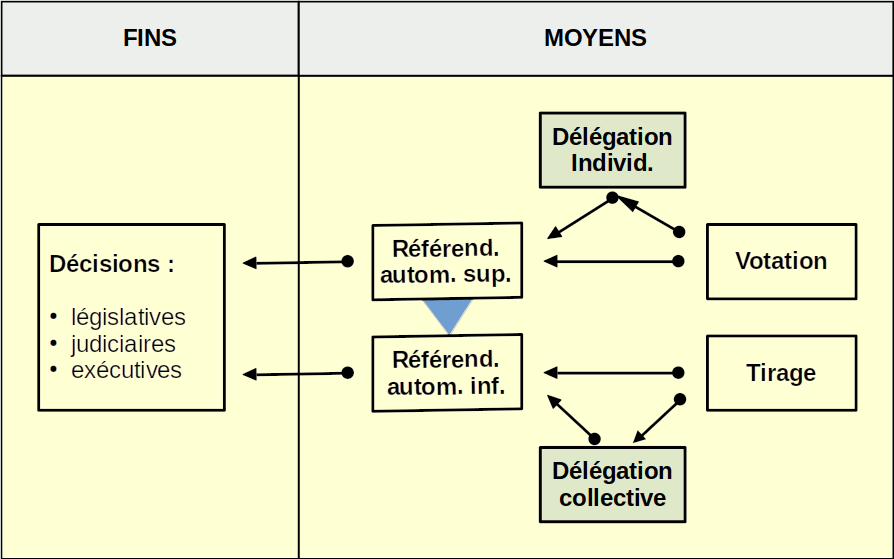
A
●
⚊
▸
B ≡ "A sert à faire B", "B par A"
A
▸
B ≡ "A prime sur B"
Lecture du schéma ci-dessus (afin de bien comprendre les trois premiers des six principes ci-dessus) :
Le concept central du système est le principe de référendum automatique.
Le référendum supérieur (en haut à gauche), qui est fondé sur la votation (en haut à droite), prime (cf. triangle bleu) sur le référendum inférieur (c-à-d peut défaire ses décisions), qui est fondé sur le tirage au sort (en bas à droite).
La participation (votation) à un référendum supérieur se fait soit directement, soit par délégation (passage par le bloc vert), au libre choix de chaque citoyen (NB : la délégation supérieure se fait pour chaque votation, et non pas une fois pour toutes les votations).
Le "référendum inférieur" (en bas à gauche) n'est pas à proprement parler un référendum, mais une réduction du système de référendum supérieur (dont il utilise le système et les principes informatiques) :
- au tirage au sort d'un nombre limité de décisions politiques (flèche horizontale inférieure), comme par exemple certaines fonctions à attribuer ;
- à la délégation collective, faite par tirage au sort des délégués, pour une période déterminée (bloc vert inférieur).
Notez que les connexion des deux flèches au bloc vert "délégation individuelle" (partie supérieure) sont convergentes, tandis que les connexion des deux flèches au bloc vert "délégation collective" (partie inférieure) sont distantes. Cette différence illustre le fait que la délégation individuelle (partie supérieure) se fait pour chaque votation, tandis que la délégation collective (partie inférieure) se fait une fois pour toute une période déterminée. C'est le fait que la délégation collective est opérée par par tirage au sort, qui justifie qu'elle perdure pendant une certaine période.
Majorité
qualifiée
Si en statistique le terme "majorité" est non ambigu (> 50%), il n'en va pas de même en politique, comme en témoigne la notion de majorité qualifiée (cf. encadré infra). L'usage systématique d'une majorité qualifiée est justifié par le fait qu'une votation n'a pas seulement pour objet de prendre une décision, mais devrait aussi inciter la collectivité à se poser les bonnes questions, c-à-d à formuler des questions dont le fond et la forme sont susceptibles de susciter un large consensus, ce qui facilite l'application effective des décisions prises. Pour déterminer de façon objective la valeur du pourcentage de majorité qualifiée, la méthode la plus simple consiste à appliquer le principe de symétrie : ( 100 / 2 + 100 / 2 / 2 ) / 100 = 1/2 + 1/4 = 75 %.
Principes de majorité
On peut distinguer quatre types de majorité, selon leur degré d'exigence : relative, simple, absolue, qualifiée :
- majorité relative (peut être la plus facile à obtenir) :
- plus de voix que les autres options, sans minimum requis ;
exemple : dans une élection à 3 candidats, si A obtient 40%, B 35% et C 25%, A gagne à la majorité relative.
- majorité simple :
- plus de 50% des membres votants ;
- Par "membres" on peut entendre plus généralement "ayants droite de vote".
- Par "non-votants" on entend ici les abstentionnistes et les émetteurs de votes non valides.
exemple : sur 100 membres, si 30 votent, la majorité simple est de 0,5 * 30 + 1 = 16 votes, et représente donc 16 / 100 = 16 % du total des membres.
- plus de 50% des membres votants ;
- majorité absolue :
- plus de 50% du total des membres (votants et non-votants) ;
exemple : sur 100 membres, la majorité absolue est de 0,5 * 100 + 1 = 51 votes, de sorte que :
si 60 membres votent, la majorité absolue représente 51 / 60 = 85 % des votes ;
la majorité absolue ne peut être atteinte si les membres votants sont moins de 50% des membres + 1;
- majorité qualifiée (peut être la plus difficile à obtenir) :
plus de ( 50 + x ) % des votants (majorité qualifiée simple) ou du total des membres (majorité qualifiée absolue) ;
pour déterminer la valeur de x de façon objective, la méthode la plus simple est d'appliquer le principe de symétrie, soit x=25% de sorte que la majorité qualifiée est de 75% : ( 100 / 2 + 100 / 2 / 2 ) / 100 = 1/2 + 1/4.
Quorum. On peut en outre stipuler qu'un vote n'est valable que si le pourcentage #présents / #absents (ou encore #voteValides / ( #abstentions + #votesNonValides ) est supérieur à une certaine valeur appelée "quorum" (notée q ci-après). Si l'on pose q = x = 75%, alors les décisions validées auraient l'agrément de 0,75 * 0,75 ≈ 56 % des ayants droit de vote (NB : 56 / ( 100 - 56 ) ≈ 1,27 c-à-d que pour cent "minoritaires" il y a 127 "majoritaires").
https://democratiedirecte.net/definition#principes-majorite
Analyse
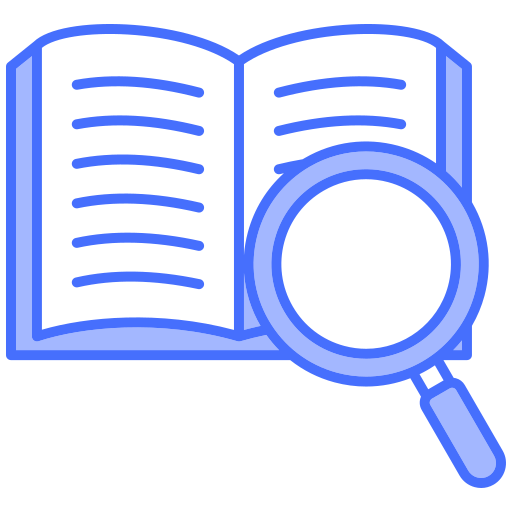
Les mots sont importants
Commençons pour exposer une confusion – caractéristique du système représentatif, et selon nous volontairement entretenue – entre les notions de vote, élection et référendum. Ainsi la définition du mot "élection" par le dictionnaire Larousse – « Choix qu'on exprime par l'intermédiaire d'un vote » [source] – associe une généralisation au niveau de la fonction ("choix", sans préciser de quoi) avec un particularisme au niveau du moyen (le vote, avec omission d'autres moyens, dont le tirage au sort). Or c'est évidemment l'inverse qu'il faut faire, sans quoi la définition est gravement biaisée. Ainsi la définition proposée par le Larousse n'est pas celle de l'élection mais de la votation !
Voici les définitions correctes :
- votation : « choix qu'on exprime par l'intermédiaire d'un vote, ce choix pouvant concerner une élection ou un référendum ».
- élection : « choix d'un candidat (par votation ou tirage au sort) ».
- référendum : « choix d'une proposition législative, judiciaire ou exécutive (par votation ou tirage au sort) ».
En raison de l'inexistence d'une culture de la DD, nous sommes conditionnés à considérer le tirage au sort en politique comme une mesure saugrenue. Mais les faits historiques et la théorie scientifique montrent que dans certains cas le tirage au sort est effectivement pertinent [approfondir : /tirage-au-sort].
Sémantique et manipulation de classe. Force est de constater que la définition du Larousse introduit un grave biais sémantique, associant "vote" à "élection de représentants", et masquant ainsi les autres fonctions du vote, ainsi que les autres modes d'élection. Le conditionnement est tellement puissant qu'il opère même sur des chercheurs en science politique, comme en témoigne cet extrait d'un article scientifique : « participation au choix des représentants (vote) » [source].
Pauvreté et asymétrie du schéma "représentatif"
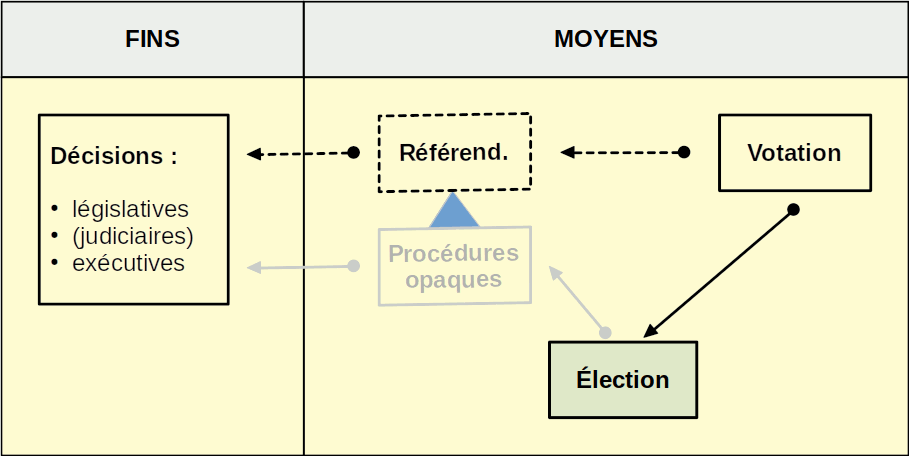
A
●
⚊
▸
B ≡ "A sert à faire B", "B par A"
A
▸
B ≡ "A prime sur B"
----- ≡ "Rare, et ne concerne pas les décisions judiciaires".
––– ≡ "Opaque".
Ces manipulations sémantiques ne sont probablement le fait du hasard : la domination de classe agit notamment au travers d'expressions dont la normativité – institutionnalisée via le contrôle des moyens de production des savoirs (dont les dictionnaires) – inhibe le sens critique des classes dominées, dès lors que celles-ci adoptent le vocabulaire de la classe dominante.
La comparaisons du schéma ci-dessus (système représentatif) avec celui de la section précédente (DD) permet d'illustrer l'effet de la définition fausse (et politique) du Larousse : placer dans l'ombre les autres possibles options.
L'animation ci-dessous permet de visualiser les modifications opérées en passant du schéma "représentatif" au schéma "DD" :
la flèche élection par votation a disparu, et avec elle le voile de fumée qu'elle dresse entre fins et moyens ;
dans le cadre vert du bas, le terme "Élection" est remplacé par "Délégation collective" ;
les deux cadres liés par le triangle bleu sont remplacés par "Référendum automatique" ;
le triangle bleu – qui exprimait la primauté de l'élection sur le référendum – est inversé, exprimant la primauté du référendum automatique supérieur sur la délégation collective et le tirage au sort ;
Animation : "représentatif" ⇒ direct
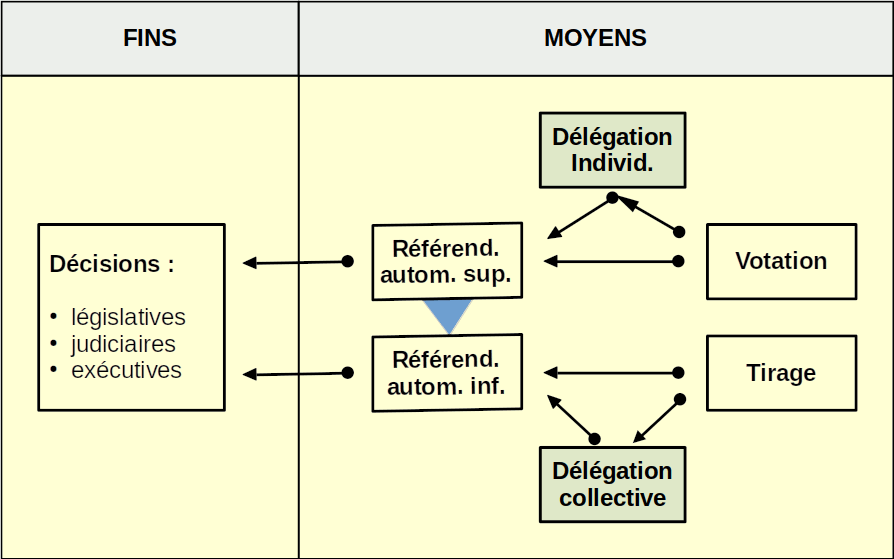
A
●
⚊
▸
B ≡ "A sert à faire B", "B par A"
A
▸
B ≡ "A prime sur B"
----- ≡ "Rare, et ne concerne pas les décisions judiciaires".
––– ≡ "Opaque".
À noter la richesse et la symétrie du schéma "DD", relativement à la pauvreté et asymétrie du schéma "représentatif" ...
Partis et
élections
Cette évolution conduira-t-elle à la disparition des partis politiques ? Probablement pas, il s'agira plutôt d'une transformation. En effet, avec la possibilité de déléguer son vote pour chaque référendum, des partis politiques pourraient proposer aux citoyens de leur confier leur droit de vote. Quoi qu'il en soit ce fait illustre la nécessité de neutraliser le risque de commerce des votes.
Comment combiner la neutralisation du risque de commerce des votes – notamment par le secret du vote – avec la possibilité pour les délégants de connaître le vote réalisé par la personne à qui ils ont confié leur droit de vote ? On pourrait sans doute rétorquer qu'il s'agit là d'un faux problème puisque le principe de la délégation est justement que le déléguant estime ne pas avoir les capacités requises pour voter à bon escient. L'important est que le citoyen décide de déléguer (ou pas) son droit de vote à chaque votation, et non pas pour une période déterminée et pour un même délégué.
Enfin, un impact majeur de notre définition de la DD est que les élections – et partant, leur logique court-termiste, rythmée par leur périodicité de quatre ou cinq ans – disparaissent, ou plutôt se dissipent dans la permanence aléatoire des votations et des éventuelles délégations de vote qui les accompagnent au cas par cas.
Constitution
La Constitution peut être vue comme la "loi des lois". C'est en tout cas un ensemble limité de principes, reconnus comme fondamentaux, qui définissent la nature du système politique, alors que les lois subordonnées organisent ce système dans le détail.
Une Constitution devrait être un document concis ne dépassant pas quelques pages et résumant les principes fondamentaux de la démocratie directe. Elle est ainsi un portail d'entrée permettant à chaque citoyen, via hyperliens, d'élargir et approfondir sa compréhension de l'ensemble du système de gouvernance ouverte, jusque dans les moindres détails.
Les six principes de base de la DD que nous avons proposés dans la section pourraient constituer la page d'entrée de la Constitution DD. Le rôle des groupes constituants ouverts consiste alors, au moyen de la méthode ICAO, à détailler chacun des principes de base.
Ces six point pourraient être précédés par un point "zéro" stipulant que « la démocratie directe est un idéal vers lequel nous voulons évoluer sans fin ».
Leçons de
l'histoire
Historiquement les Constitutions furent conçues et rédigées par une assemblée constituante. Une problématique majeure de toute "constituante" est sa légitimité et donc sa représentativité. Ainsi les Constitutions issues des révolutions américaine (1787) et française (1789) furent conçues sous le contrôle de la grande bourgeoisie industrieuse, qui a masqué ses intérêts de classe sous un glacis de "démocratie représentative" [approfondir].
Il importe donc de ne pas verser dans le comportement magique : il ne suffit pas de déclarer la démocratie au moyen d'une Constitution pour qu'elle soit ! Contrairement à ce que pourrait laisser penser le message propagé par Étienne Chouard, qui focalise sur la thématique des ateliers constituants, la Constitution n'est pas la source du pouvoir de ses rédacteurs ! La source du pouvoir c'est le contrôle des moyens de production des biens & services essentiels ! Autrement dit, pour obtenir une Constitution réellement démocratique, il convient d'assurer préalablement le contrôle démocratique des moyens de production essentiels. Selon notre analyse, ce contrôle peut être réalisé par le biais d'entreprises (100 %) publiques, et gérées sous statut de coopératives publiques [approfondir].
Bien sûr, la Constitution de DD devrait rappeler le caractère fondamental d'une économie mixte (c-à-d avec des entreprises publiques pour concurrencer les entreprises privées) et décentralisée (cf. entreprises publique gérées sous statut de de "coopératives publiques"), comme double condition nécessaire de la démocratie.
Retenons que pouvoirs constitutionnels et pouvoirs économiques (production et finance) sont intriqués. Cette question est développée dans le chapitre suivant, consacré aux conditions économique de la DD.
Pouvoirs constitutionnels
Dans l'actuel système "représentatif" les détenteurs des trois pouvoirs constitutionnels sont :
- à l'exécutif : les ministres et le chef effectif (officieux) du gouvernement (président ou premier ministre) ;
Dans le système "représentatif" les ministres ne sont pas élus mais désignés par le chef du pouvoir exécutif (le premier ministre ou le président selon les pays). Celui-ci est généralement issus des classes aisées.
- au législatif : les parlementaires ;
La prétendue "représentativité" des parlementaires est factice car la majorité d'entre eux font partie du 1% des plus riches de la population [exemple].
- au judiciaire : les juges.
Dans le système "représentatif" les juges suprêmes sont nommés essentiellement par le pouvoir exécutif, ce qui explique que, en général, la justice est une justice de classe, et que le pouvoir judiciaire est inféodé à l'institution du pouvoir exécutif.
Force est également de constater la réalité d'un "quatrième pouvoir", non constitutionnel, constitué de deux pôles :
- les entreprises de presse, sous contrôle de leurs propriétaires, mais aussi, de façon informelle, par le pouvoir exécutif ;
- des organisations internationales telles que le FMI et l'OMS, qui constituent des lobbies officieux des secteurs bancaire et pharmaceutique.
Les trois secteurs industriels où l'on observe le plus de condamnations judiciaires sont dans l'ordre : (1) finance ; (2) pharmacie ; (3) énergie [source]. Cependant, dès lors que les amendes infligées ne représentent qu'une partie des bénéfices générés via la corruption, alors elles ne sont en réalité que des "taxes" sur la corruption (PS : la prison ferme pour les PDG, ou la nationalisation seraient bien plus efficaces)...



