I. Introduction
Ce site web democratiedirecte.net est une publication en édition continue. Son contenu est ainsi régulièrement augmenté et amélioré, cela depuis le début des années 2000. Elle représente à ce jour 392 pages en équivalent PDF. La publication web democratiedirecte.net est également accessible via le site portail de l'auteur : jortay.net.
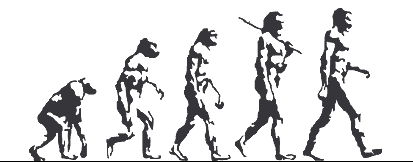
Saut évolutif
La société humaine évolue toujours plus vite, et se complexifie. Aujourd'hui l'état des technologies n'est plus constant à l'échelle temporelle d'une vie humaine, ni assimilable individuellement dans sa globalité. Le système représentatif moderne, né au 18° siècle, n'est plus adapté à ce nouvel environnement. Le mode de gouvernance des États – mais aussi des organisations privées (entreprises, syndicats, ONG, , ...) – doit par conséquent se transformer en un système adaptatif, et fondé sur l'intelligence collective.
Il s'agit donc de dépasser le stade primaire de l'élection et des manifestations, pour évoluer vers un stade supérieur, où le citoyen n'est plus observateur et quémandeur mais acteur proactif de la vie politique. Cette évolution est rendue possible par l'intelligence artificielle (IA), qui peut faciliter la décentralisation du savoir, et accélère la baisse du temps de travail économique, libérant ainsi du temps pour le travail politique. Un saut évolutif semble donc nécessaire, et faisable. La présente publication s'inscrit dans cette vision, en proposant une théorie prospective et proactive de la démocratie directe.

Théorie
pratique
Notre objectif est d'identifier un ensemble cohérent de réponses concrètes à la question : comment concevoir et développer collectivement un système de DD ? En apportant des éléments de réponse à la question du "comment" (faisabilité), un éclairage est indirectement porté sur le "pourquoi" (souhaitabilité).
Postulat. Cette démarche repose ainsi sur un postulat initial – "la démocratie directe est l'idéal démocratique" – dont la pertinence est fondée sur (i) l'effet responsabilisant et émancipateur de la DD sur les individus, et (ii) le développement d'une intelligence collective. À l'opposé, la technocratie n'est pas une option, dans la mesure où (a) elle est sociologiquement biaisée, (b) elle infantilise les populations, (c) elle facilite la corruption (en raison du faible nombre de décideurs).
Praxis. Dans la présente conception de la DD, le processus collectif de décision (et non pas seulement processus de décision collective) est aussi important que la décision elle-même. Car la pratique du débat collectif, qui précède la prise de décision, stimule l'autoformation et la cohésion de la population.
Progrès. En tant qu'idéal, la démocratie parfaite, c-à-d la démocratie directe, est probablement inatteignable. Mais elle indique la direction à suivre d'un progrès sans fin. Ce point fondamental devrait constituer le premier article de la Constitution de tout pays se revendiquant démocratique.
Approche
structurée
La présente publication est conçue sur cinq piliers conceptuels : définition de la DD ; infrastructure du système ; méthodologie de conception collective par des groupes constituants ; démarrage par le bas ; conditions politico-économiques de réalisation :
-
Définition : nous proposons six principes de base de la démocratie directe :
- Primauté du référendum supérieur sur la délégation collective et le tirage au sort.
Les référendums sont d'initiative populaire et opérés par la procédure de référendum automatique.
- Deux types de délégation du vote :
- individuelle, par chaque citoyen, pour chaque votation spécifique ;
- collective, par tirage au sort, pour une durée déterminée.
- Deux types de délégué : humain ou IA.
- Les principes précédents sont applicables à toutes les échelles (locale, nationale) et types de pouvoir constitutionnel (exécutif, législatif, juridique).
Les groupes constituants déterminent tout ce qui reste à déterminer pour obtenir un système de DD opérationnel, et le faire évoluer.
- Infrastructure : deux options, complémentaires ou exclusives :
non informatique (implémentation "blanche") : ainsi le bureau de poste, dont jadis chaque quartier disposait, pourrait être rétabli en tant que bureau de votation permanent.
informatique (implémentation "noire") : vote par Internet et possibilité de délégation à des IA open source.
Méthodologie ICAO : pour concevoir et développer collectivement un système de DD fondé sur les principes énoncés dans les points "Définition" et "Infrastructure" ci-avant, nous proposons une méthodologie qui vise à activer la propriété d'émergence de l'intelligence collective, via le phénomène d'auto-organisation.
Démarrage : par sa nature même, la DD doit être réalisée par la base, c-à-d des individus, disposant des compétences techniques nécessaires, et organisés au sein d'associations locales. Ainsi, pour participer à l'évolution culturelle et technologique vers l'idéal démocratique, le lecteur est invité à :
s'imliquer dans la vie associative en tant que membre effectif, et y promouvoir la cogestion (pour l'y aider, voici un manuel de cogestion associative).
intégrer dans son mode de vie l'autoformation – permanente et par la pratique – des techniques informatiques utiles en tant que producteur individuel de travail économique aussi bien que politique.
Conditions : enfin, pour s'étendre du niveau local à l'échelle globale, la DD requiert un contrôle démocratique des moyens de production essentiels. Ce contrôle peut être exercé au moyen de coopératives publiques. L'image du dilemme de la poule et de l'oeuf illustre ici une dynamique complexe, en boucle de rétroaction. Complexe, mais sans doute pas impossible ...
Réalisation
Bien que nos travaux apportent de nombreux éléments suggérant la souhaitabilité et la faisabilité de la DD, ceux-ci ne sont que théoriques. D'autre part, les expérimentations ne peuvent être que partielles, locales et temporaires, de sorte que leurs résultats ne lèvent pas toutes les incertitudes, notamment celles liées à la généralisation de la DD. Mais comme d'autre part il ne semble pas exister d'alternative pour supplanter la DD en tant que système politique idéal, sa souhaitabilité paraît tout autant évidente. Il ne reste alors plus que la question de la faisabilité, à laquelle répond précisément la présente publication, en proposant notamment des modes d'actions individuelles et collectives.



