IX. Tirage au sort
Cas particuliers

Dans ce chapitre, nous allons montrer dans quels cas le TS peut s'avérer une alternative pertinente par rapport à la votation. Soulignons déjà ici que le TS constitue une forme de confiscation démocratique par rapport à la votation, notamment en terme d'éducation & responsabilisation par la participation ouverte. Il y a donc un arbitrage à opérer.
À cet égard, le (gigantesque) travail des groupes constituants consiste (notamment) à proposer à la votation constituante dans quels types de décisions constitutionnelles est appliqué :
- le référendum :
- par votation ;
- par TS : il s'agit de TS de la décision, et non de délégués, dans des cas, simples et assez rares, où le TS pourrait être préféré à la votation (PS : on considère qu'il s'agit, malgré tout, d'un "référendum, parce que le choix de recourir au TS pour certains cas de décisions est opéré par votation dans le cadre d'un référendum constituant).
- la délégation collective par TS (et dans ce cas, dans quels quels types de décisions constitutionnelles les candidats au tirage au sort devront répondre à des critères de compétence).
Enfin, avant d'entrer dans le vif du sujet (le TS : quand, pourquoi, comment), rappelons ici le schéma de notre définition de la DD (approfondir : /definition) :
Richesse et symétrie du schéma DD
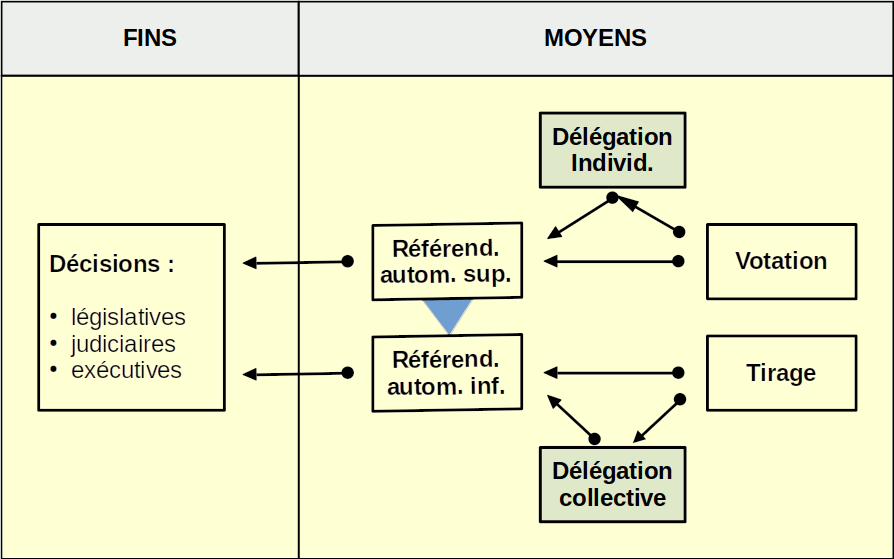
A
●
⚊
▸
B ≡ "A sert à faire B" ou "B par A"
A
▸
B ≡ "A prime sur B"
Histoire et motivations
En politique le tirage au sort n'est quasiment plus d'application aujourd'hui mais était couramment pratiqué dans la Grèce et la Rome antiques. Il fut également utilisé dans la Chine impériale (221 av. J.-C. à 1912) durant plus de trois siècles, afin de répartir les provinces entre les hauts fonctionnaires qui avaient passé avec succès les examens impériaux [source]. Enfin il est toujours d'usage dans la sphère judiciaire, notamment pour désigner des jurés d’assises.
La question du TS en politique connaît un fort regain d'intérêt depuis les années 1990, notamment dans les milieux scientifique, politique et militant.
Les avantages démocratiques attribués au tirage au sort en politique sont souvent résumés en deux termes : égalité et neutralité, notamment, pour ce qui concerne l'élection, en raison d'une meilleure représentation de la diversité culturelle de la population par les délégués lorsque ceux-ci sont désignés/élus par TS plutôt que par votation.
Justification
Nous allons ici illustrer, dans les domaines de la délégation et de l'éducation, l'égalité et la neutralité attribuées au TS.
1. Délégation collective par TS2. TS + rotation = éducation
Délégation collective par TS
Qu'il s'agisse des parlementaires (pouvoir législatif), ministres (pouvoir exécutif) et juges (pouvoir judiciaire) de l'actuelle démocratie représentative, ou des délégués de la future démocratie directe, le tirage au sort permettrait de rendre les détenteurs des pouvoirs constitutionnels statistiquement représentatifs de l'ensemble de la population (52 % de femmes, 22 % d'ouvriers, etc).
Cette meilleure représentativité est souvent supposée se faire au détriment de la compétence. Cependant nous verrons que de récentes études sur l'intelligence collective suggèrent que ce n'est peut-être pas toujours le cas.
Les expérimentations du TS révèlent généralement des effets positifs sur quatre types de biais :
Biais financiers. Dans le processus d'élection par votation les candidats/partis riches (ou ceux qui sont sponsorisés par des riches) bénéficient de plus de couverture médiatique que les candidats/partis pauvres, ce qui explique que la classe politique est plus proche de la minorité des plus riches que de la majorité de la population (NB : la richesse/pauvreté s'exprimant ici autant en capital financier que relationnel). L'élection par tirage au sort est politiquement plus juste en cela qu'elle neutralise ce phénomène.
Biais "idéologiques". En comparaison avec l'élection, le TS permet de neutraliser (ou du moins limiter) des phénomènes tels que les instructions de parti, les conflits de pouvoir, les luttes de factions, ou encore les coups bas, qui opèrent avant comme après le processus électoral.
Biais psychiques : des délégués "déprofessionnalisés" par un tirage au sort avec mandats courts sont psychiquement moins déstabilisés (*), plus impartiaux et constructifs.
(*) La personne choisie ne peut se voir comme supérieure aux non-choisis, ni inférieure à un élu ayant reçu plus de voix, car elle n'a pas été élue pour des raisons qui ont trait à sa personne.
Biais cognitifs. Les délégués tirés aux sort sont nécessairement répartis plus également dans la distribution sociologique de la population. Or Lu Hong and Scott Page (2004) auraient établi qu’en raison des bénéfices de la diversité cognitive (c’est-à-dire la diversité des intelligences et des perspectives), des groupes non experts mais diversifiés sont souvent meilleurs, dans la résolution de problèmes complexes, que des groupes d’experts [source]. Approfondir : /intelligence#emergence
Préserver la diversité. Les mécanismes sociologiques font qu'un groupe d’individus initialement divers devient moins divers au cours du temps. Par conséquent pour préserver la diversité sociologique le groupe doit recevoir l’apport périodique de nouveaux membres. L'on voit ici que la rotation des mandants est une condition nécessaire d'une diversité durable.
TS + rotation = éducation
Dans les cas où aucun critère de compétence n'est requis pour les élus par TS, la logique de cette méthode est fondée sur le partage plutôt que sur l'accumulation de l'expérience politique. Cette logique de partage maximum implique (i) que la durée d'un mandat devrait être minimale (nous proposons une année c-à-d un cycle saisonnier), et (ii) que chaque citoyen devrait n'avoir droit qu'à un seul mandat dans sa vie. La rotation rapide des mandats et leur unicité dans la vie du mandaté induisent une plus grande implication de la population dans le processus gouvernemental, favorisant ainsi – par la pratique – l'éducation et la responsabilisation politique.
Certes, on ne peut ainsi éduquer par la pratique l'entièreté de la population, raison pour laquelle, dans un système de DD, les principes élémentaires de la science politique devraient être inclus dans le programme de l'enseignement obligatoire [approfondir : /conditions#information-enseignement].
Formes
Les propositions de tirage au sort (TS) en politique connaissent une popularité croissante depuis les années 1980.
1. Forme représentative faible2. Forme représentative forte
3. Forme directe
Forme représentative faible
Les personnes favorables au système représentatif voient dans le TS un moyen de renforcer sa légitimation et éventuellement d'en améliorer le fonctionnement, de sorte qu'il s'agit généralement d'une forme "faible" de TS : en général sa fonction est consultative plutôt que décisionnelle, et limitée au pouvoir législatif. Deux applications sont la chambre consultative et les sondages délibératifs.
1. Chambre consultative2. Sondage délibératif
3. Bilan
Chambre consultative
Pierre-Etienne Vandamme considère (de façon optimiste) cette forme faible : « Ce Sénat tiré au sort devrait disposer d’un pouvoir d’initiative, de seconde lecture et d’amendement, mais pas de veto. (...) La chambre tirée au sort ne serait-elle alors qu’un os à ronger pour le peuple ? Je ne crois pas. Étant donné la perception très positive dont elle jouirait probablement auprès du grand public en raison des effets de similarité et "d'ordinarité", les élus seraient fortement incités à courtiser son consentement, et donc à prendre en compte son avis et ses propositions d’amendement, voire à s’emparer de ses propositions législatives. Si la majorité (N.d.A : gouvernementale) ne le fait pas, l’opposition s’empressera vraisemblablement de se réclamer de cette autre légitimité "populaire", gagnant probablement en popularité auprès du grand public. En réaction, la majorité serait obligée de se montrer elle aussi plus attentive aux avis de la chambre tirée au sort. Il y a donc fort à parier qu’une telle réforme aurait des effets délibératifs non négligeables » [source].
Pour Courant et Sintomer, il s'agit de compléter la représentation "élective" par une représentation "descriptive" [source]. Cependant cette chambre consultative est une démarche "top-down", et non l'inverse, de sorte qu'il ne s'agit pas de délégation collective. Le fait que les membres de cette chambre soient tirés au sort n'y change évidemment rien.
Sondages délibératifs
Depuis le début du siècle, de nombreux scientifiques militants promeuvent le concept de "sondage délibératif" (ou encore "mini-publics délibératifs" selon l'expression d'Yves Sintomer). Ces dénominations alambiquées doivent éveiller notre sens critique, car ces contorsions intellectuelles et sémantiques sont souvent le signe d'une démarche enfumante. Ainsi le "sondage délibératif" est associé à la "démocratie participative" (voire seulement "délibérative"), qui est à la "démocratie représentative" ce que le "green washing" est aux industries polluantes.
Le concept du mini-public repose sur la thèse selon laquelle la délibération ne serait pas possible à l'échelle de l'ensemble de la population pour des raisons de logistique. Or nous avons montré que cette allégation est probablement fausse [vidéo 2].
On peut caractériser le sondage/mini-public délibératif en cinq points [source] :- constitution aléatoire d’un échantillon représentatif de la population (environ 400 personnes) ;
- présentations analytiques de thématiques par des experts ;
- auditions de parties prenantes ;
- délibération collective ;
- durée d'un ou deux week-end.
Deux observations reviennent presque systématiquement :
le taux de personnes sélectionnées acceptant de participer est très faible : en moyenne autour de 2 % quand aucune rémunération n’est fournie aux participants, montant à 10-15 % quand un dédommagement est proposé [source] ;
En outre les déformations de la structure sociodémographique des répondants au cours du processus de sélection et les écarts notables à la structure initialement prévue sont des phénomènes que l’on retrouve à des degrés variables dans tous les processus de sélection d’un mini-public [source]. Dans ces conditions le caractère "représentatif" du groupe peut ne plus être vérifié ...
à l’aide de questionnaires soumis aux participants avant et après l’expérience, on observe généralement que (i) les opinions ont substantiellement changé ; (ii) les participants auraient une "meilleure" compréhension des thèmes abordés (mais la question demeure de savoir si les référentiels par rapport auxquels la compréhension est jugée meilleure ne sont pas biaisés ...).
- Selon John Gastil la participation à ce type d’expérience produirait des positions plus "cosmopolites" et ouvertes, sans orienter systématiquement les individus vers des positions "progressistes" [source].
- Des expériences en laboratoire ont cependant montré que la discussion collective peut conduire à une polarisation des opinions [source].
Bilan
Comprenons bien cependant qu'en soi le mini-public ou sondage délibératif n'est aucunement une instance ni une procédure démocratique, mais seulement une technique de sondage, "améliorée" car portant sur une opinion publique plus "éclairée". Mais éclairée par qui, comment et dans quels buts (officiels et officieux) ... ? Selon Loïc Blondiaux, le tirage au sort, en sélectionnant des citoyens sans qualité, le plus souvent sans affiliation associative ou partisane, reviendrait à constituer un public docile [source]. D'autre part, des expériences ont montré que les résultats de sondages délibératifs organisés dans le cadre "d'assemblées citoyennes" sélectionnées et coachées peuvent être largement rejetés par des référendums ultérieurs [source § 39]. Cela est très probablement le cas lorsque l'information du mini-public est biaisés par l'opinion des organisateurs des séances d'information. On notera à cet égard que le g1000.org (Belgique) auquel les médias ont fait tant de publicité est en réalité un sous-marin de fédérations patronales belges [source : Bert Bultinck, rédacteur en chef du Standaard Week-End, cité dans Le Soir du 05/11/2011].
"Demo
washing"
Pour Yves Sintomer la mise en place de ces procédures participatives provient moins de revendications par en bas que d'un choix imposé par en haut, souvent par des think tanks, en vue de fournir un nouveau moyen de légitimation aux autorités politiques en pleine crise de représentation [source].
Montages complexes. La forme faible est prolixe en inventions de montages divers en matière de délégation, notamment les combinaisons "votation puis tirage" ou inversement. Ces complexifications ont généralement en commun de réintroduire l'élection par votation, l'instrument favori de toute classe dirigeante ...
Forme représentative forte
Je n'ai pas connaissance de propositions de forme "forte" de TS, à savoir de système représentatif dont tous les élus aux trois pouvoirs constitutionnels (législatif, exécutif et judiciaire) seraient tirés aux sort. On notera que, d'un point de vue technocratique, la forme forte serait rationnelle dès lors que les candidats à l'élection par TS devraient vérifier des critères de compétence.
Forme directe
Des partisans de la démocratie directe peuvent voir le TS comme un moyen d'apporter une solution aux limitations du référendum. Ainsi dans nos principes de base de la DD (cf. /definition), les délégués tirés au sort – pour un mandat d'un an maximum, avec dans certains cas des conditions de compétences particulières – disposent d'un pouvoir décisionnaire dans n'importe lequel des trois pouvoirs constitutionnels (législatif, exécutif ou judiciaire), mais toujours subordonné au référendum (droit de véto et de contre-proposition via procédure référendaire).
La forme directe du TS est démocratiquement supérieure à la forme forte (et partant, à la forme faible) car :
elle dispose d'un pouvoir de décision, ce qui n'est généralement pas le cas de la forme faible dès lors qu'il s'agit du droit à être consulté, ce qui est très éloigné du droit de décider ;
les délégués tirés au sort sont subordonnés aux vetos et amendements référendaires, ce qui n'est pas le cas de la forme forte.
Soulignons ici que dans notre définition de la DD, le système bicaméral actuel (chambre des représentants et sénat) est remplacé par un système de deux types de délégation :
individuelle, pour une votation spécifique (on ne peut donc parler de chambre) : le votant peut déléguer son droit de vote à une personne de son choix, laquelle peut éventuellement déléguer les droits dont elle dispose, et ainsi de suite (délégation "en cascade" rendant possible la spécialisation) ("démocratie liquide") ;
collective, pour une période déterminée : les délégués sont tirés au sort, si nécessaire dans des pools de candidats répondant à des critères de compétence (PS : c'est donc la seule chambre qui subsiste).
Limites
Système mixte. Lorsque le TS ne constitue qu'un élément de réforme partielle du système représentatif, c-à-d lorsqu'il fait cohabiter "amateurs" et "professionnels", c'est à l'avantage des seconds, de sorte que dans ce cas le TS, loin de constituer un progrès démocratique, n'est au contraire qu'une régression [source].
Biais social ? Le TS ne supprime pas tous les biais "d'auto-sélection" : certaines catégories sociales seront plus susceptibles de présenter leur candidature au tirage au sort. Mais il demeure que le tirage au sort constitue un progrès vers une répartition sociologique plus large. D'autre part, peut-être les groupes constituants découvriront-ils des cas où il est pertinent que les individus constituants le pool de tirage soient contraints légalement (il peut s'agir de l'ensemble de la population).
Corruption. Si la corruption pré-électorale est certes amoindrie par le TS (plus de campagne électorale à financer), demeure cependant la corruption post-électorale (c-à-d après l'élection par tirage au sort). Et à cet égard l'absence de promesse électorale et d'instructions/contrôle de parti ne sont plus là pour limiter les risques. Cependant l'argument selon lequel l'élection des délégués par votation présenterait au moins l'avantage que les élus "ont des comptes à rendre à la prochaine élection" n'est que rarement confirmé par les faits. Et d'autant plus si l'on considère que la diversité des partis masque une très faible diversité socio-économique au sein de la classe politique, de sorte que l'éventuelle "sanction" des élections n'a que peu d'effet politique réel (autre que purement médiatique). Quant aux partis, on peut les voir autant comme des machines à corruption que comme des remparts contre celle-ci. Enfin, de toute façon, le TS ne va probablement pas impliquer la disparition des partis, qui pourraient très bien proposer leurs délégués collectifs aux élections par TS (partie inférieure du #schema-definition-DD) et leurs délégués individuels pour des votations (partie supérieure du #schema-definition-DD).
Quant à la brièveté et l'unicité du mandant, elles limitent probablement le risque de professionnalisation de la corruption, mais cela n'est pas propre à l'élection par TS et vaut également pour les élus par votation. D'autre part, dans un cas comme dans l'autre, la corruption d'un élu peut se faire en quelques instants.
Compétence des délégués
Dans certains cas (lesquels ? : à déterminer par les groupes constituants) les candidats à l'élection par TS devraient répondre à des critères de compétence.
- La compétence en politique peut être caractérisée en trois types : procédurale, thématique et pratique.
- Hélène Landemore définit la "méta-incompétence" comme l'incapacité à prendre conscience de son incompétence particulière [source].
Il convient donc de déterminer une procédure de qualification & contrôle des compétences (travail des groupes constituants). Rappelons à cet égard que les délégués (également ceux de la délégation en cascade des référendums) pourraient être des humains ou des IA (cf. /intelligence#artificielle).
Durant les périodes démocratiques de la Grèce antique, environ 15% des charges gouvernementales étaient électives. Il s'agissait des charges considérées comme requérant un savoir-faire particulier. Les autres charges étaient tirées au hasard parmi les citoyens volontaires [source]. Le modèle de democratiedirecte.net suggère plutôt (i) que la désignation de délégués aux pouvoirs constitutionnels est mieux opérée par le tirage au sort parmi un pool de candidats répondant à des critères de compétence, et (ii) que les décisions des délégués peuvent être amandée ou supprimées par la voie référendaire.
Expert vs décideur
Le décideur doit transformer l'avis nuancé (probabiliste --> non-binaire) de l'expert, en une décision, difficilement voire impossiblement nuancée (oui/non --> binaire) [approfondir]. D'autre part, il importe que soient reconnues toutes les formes d’expertises, y compris celles des « petits métiers » ainsi que « du vécu » [approfondir].
On notera enfin la contradiction dans l'affirmation de la classe dirigeante affirmant que la population n'a pas les compétences pour gouverner mais l'aurait par contre pour désigner (via les élections) les personnes supposées détenir ces compétences ...
Volontariat ?
- Oui : il faudrait avoir préalablement posé sa candidature.
- Non : l'obligation neutralise les biais d'auto-sélection (cf. supra #limites), et stimule le partage d'expériences.
Défis
Sécurité
La procédure technique du tirage au sort devra être sécurisée et transparente (ces deux propriétés n'étant pas facilement conciliables ...) afin que la nature aléatoire de ses résultats ne soit pas mise en doute par la population.
Particratie
recyclée
Le système de partis (et ses inconvénients) ne risque-t-il pas de réapparaître sous une autre forme ? Par exemple, les partis pourraient organiser des candidatures massives aux élections par tirage au sort, et faire la publicité de leur délégués individuels ("délégation en cascade" aux votations). Et cela vaut aussi pour des entreprises ou des personnes fortunées. Les groupes constituants devraient donc concevoir des mesures pour neutraliser ce risque.
Récupérations et détournements
Récupération
Il importe de ne pas se laisser duper par les tentatives de récupération et de neutralisation que tente déjà la classe politique. Ainsi en 2015 une politicienne belge a eu le culot de présenter le tirage au sort comme « une idée personnelle » (sic), et de proposer que le Sénat devienne mixte c-à-d composé de politiciens et de citoyens. Outre le fait qu'elle maintient une classe de politiciens professionnels, cette proposition n'est selon nous que de la poudre au yeux car le Sénat belge n'a quasiment plus aucun pouvoir. Dans ces conditions il est hautement probable que ce ne sont pas quelques citoyens tirés au sort qui redonneraient du pouvoir au Sénat, mais le Sénat et ces quelques citoyens qui seraient instrumentalisés pour maintenir en vie le spectacle du régime "représentatif" [source].
Plus c'est gros ... La proposition de la politicienne est d'autant plus culottée qu'il s'agit de Laurette Onkelinx, qui fut ministre sans discontinuité pendant 15 ans ! [source].
Détournement
Une alternative proposée par la sociocratie et l'holacratie est l'élection sans candidat. Ces techniques de management développées dans des entreprises privées sont fondées en outre sur (i) le rôle d'un médiateur et (ii) l'absence de vote secret. Outre le fait que l'abandon du vote secret constitue une grave régression démocratique, la sociocratie et l'holacratie ignorent toute la problématique de la propriété (du capital) de l'organisation, comme s'il n'y avait pas de différence fondamentale entre une entreprises privée (ou une association subsidiée) en pseudo-démocratie et une coopérative publique en démocratie directe. Il importe donc de ne pas confondre ces nouvelles techniques de management avec la démocratie directe. Il est en effet dans l'intérêt de toute classe dirigeante d'entretenir cette confusion [élection sans candidat : théorie et pratique].



